Comment le stoïcisme de Marc Aurèle peut vous aider à mieux courir… et à mieux vivre
Douze semaines de préparation minutieuse, des séances calibrées, une hygiène de vie exemplaire… et le jour du marathon, tout s’effondre. Pluie battante, vent de face, un début de grippe ou ce fameux mur du 30ᵉ kilomètre. Vous avez tout respecté, et pourtant, la réalité vous échappe.
La question surgit alors : pourquoi moi ?
Et si la réponse se trouvait dans la philosophie ? Plus précisément, dans celle d’un empereur romain du IIᵉ siècle : Marc Aurèle. Sa pensée, le stoïcisme, vieille de près de 2000 ans, pourrait bien transformer votre manière de courir… et, peut-être, votre manière de vivre.
Marc Aurèle, l’empereur philosophe
Bien avant de devenir un personnage de cinéma, Marc Aurèle fut un dirigeant d’une humilité rare. Alors que Rome traversait des crises militaires, économiques et sanitaires, il choisit de partager le quotidien de ses soldats sur le front, dormant dans les camps, affrontant le froid et la fatigue.
Plutôt que d’écraser son peuple sous l’impôt, il prit une décision radicale : vendre les trésors impériaux pour financer la défense du territoire.
Mais ce qui rend Marc Aurèle intemporel, ce ne sont pas ses décisions politiques. Ce sont ses réflexions personnelles, consignées dans un journal intime intitulé Pensées pour moi-même.
Dans ces pages, une idée revient sans cesse :
« Nous ne contrôlons pas les événements, mais notre réaction aux événements. »
C’est l’essence du stoïcisme : distinguer ce qui dépend de nous, de ce qui ne dépend pas de nous — et agir en conséquence.
Ce que le stoïcisme enseigne au coureur
Être stoïcien, ce n’est pas devenir froid ou insensible. C’est apprendre à se concentrer sur ce que l’on peut réellement maîtriser : son effort, son attitude, ses choix.
Pour le reste — la météo, les autres, le sort — inutile d’y gaspiller son énergie. Comme l’écrivait Marc Aurèle, « ce n’est pas l’événement qui te trouble, mais le regard que tu portes sur lui. »
Appliqué à la course à pied, ce principe devient un outil mental redoutablement efficace. Voyons-le à travers trois situations concrètes que tout coureur a déjà connues.
Trois situations, trois réponses stoïciennes
1. La veille de la course : apprendre à lâcher prise
Vous consultez frénétiquement la météo : pluie, vent, froid. La panique monte.
Le stoïcien, lui, se recentre. Il ne peut pas influencer le ciel, mais il peut ajuster sa tenue, revoir son plan de course, adapter sa stratégie.
Changer de regard sur la situation, c’est déjà retrouver de la sérénité.
2. Le mur du 30ᵉ : accueillir la douleur sans la dramatiser
Lorsque les jambes brûlent et que le mental vacille, Marc Aurèle rappellerait :
« La douleur est inévitable. Ce qui dépend de toi, c’est la place que tu lui accordes. »
La souffrance fait partie du chemin. Elle est une donnée, non une fatalité. Celui qui l’accepte sans s’y attacher conserve la lucidité nécessaire pour agir : ralentir, respirer, tenir.
3. L’échec : transformer la déception en apprentissage
La course est terminée. L’objectif n’est pas atteint.
Le réflexe stoïcien : analyser plutôt que se juger.
« Se plaindre, c’est se blesser soi-même. Les choses arrivent comme elles doivent arriver. »
L’échec devient alors un matériau de progression, une étape sur le chemin plutôt qu’une fin en soi.
Le piège du succès
Le stoïcisme ne met pas seulement en garde contre la douleur, mais aussi contre la gloire.
Un record personnel, une victoire, une performance peuvent rapidement devenir un poids. À force de s’identifier à ses réussites, on finit par en être prisonnier.
Marc Aurèle écrivait qu’il fallait agir avec excellence, puis passer à autre chose.
Comme la vigne donne du raisin sans rien attendre, le coureur doit apprendre à se réjouir de son effort sans en faire un trophée permanent. Chaque course est une nouvelle page.
Quatre réflexions stoïciennes pour le coureur moderne
1. Qu’est-ce qui dépend vraiment de moi ?
On croit souvent contrôler sa forme, sa motivation ou son résultat. En réalité, on ne maîtrise que ses actions : s’entraîner, se reposer, bien manger, s’aligner au départ. Ce changement de perspective libère l’esprit.
2. Que faire de la peur ?
« Ne dis pas : j’ai perdu cela. Dis : je l’ai rendu. »
Tout est provisoire : la santé, la forme, la réussite. Prendre conscience de cette fragilité n’est pas angoissant, c’est au contraire un appel à savourer le moment présent. Et à courir avec intensité.
3. Pourquoi je cours ?
Le stoïcisme valorise quatre vertus : justice, force, tempérance, sagesse.
La question n’est donc pas seulement « Suis-je performant ? » mais plutôt « Suis-je aligné avec mes valeurs ? »
Une performance n’a de sens que si elle s’inscrit dans une cohérence personnelle.
4. Que faire de l’ego ?
Les comparaisons incessantes, les statistiques, les réseaux sociaux nourrissent l’ego plus qu’ils n’alimentent la passion.
Marc Aurèle poserait une question simple :
« Pourquoi accorder plus d’importance à l’opinion des autres qu’à la tienne ? »
Courir pour être vu, c’est perdre de vue l’essentiel.
Un exercice concret pour s’entraîner au lâcher-prise
Prenez une feuille ou une application et tracez deux colonnes.
Dans la première, notez ce qui dépend de vous : votre discipline, votre sommeil, votre alimentation, votre mental.
Dans la seconde, ce qui ne dépend pas de vous : la météo, les imprévus, les performances des autres.
Relisez cette liste chaque semaine. Lâchez prise sur la seconde colonne, concentrez votre énergie sur la première.
Cet entraînement, aussi simple soit-il, prépare autant l’esprit que le corps.
En conclusion
« Je n’ai pas choisi l’obstacle, mais je choisis ma réponse face à cet obstacle. »
Le stoïcisme n’est pas une philosophie poussiéreuse. C’est une discipline mentale d’une modernité saisissante : une manière d’apprendre à rester calme dans le chaos.
Qu’il pleuve, que la douleur monte ou que le chrono déraille, souvenez-vous de Marc Aurèle.
Vous n’avez pas besoin d’une toge pour être stoïcien — seulement d’un peu de lucidité, et d’un regard apaisé sur l’effort.

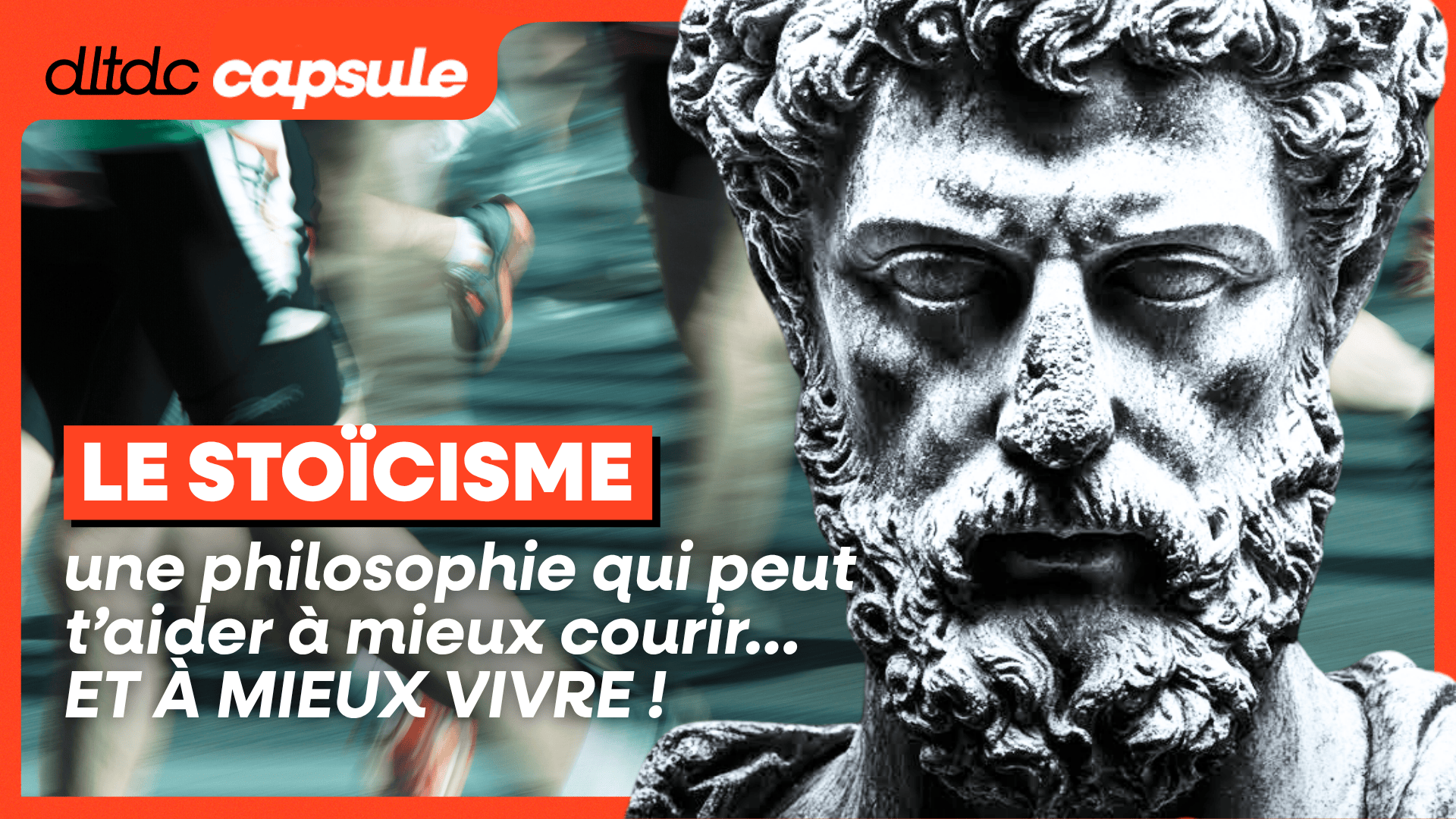


Avec Road to Paris, Dans la tête d’un coureur vous propose de vivre votre préparation pas à pas, en mettant des mots sur ce que des milliers de coureurs s’apprêtent à traverser avant le Marathon de Paris 2026.
Dans ce deuxième épisode, enregistré en direct de l’ASICS House, on continue ensemble à se motiver… même quand la pluie ne cesse de tomber, que les sorties longues s’allongent et que le doute commence à s’installer.